Direction des programmes Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique
Direction des Services multidisciplinaires
—
Au CCSMTL, les criminologues occupent différents postes dans plusieurs secteurs et directions.
Henri Themens, lui, est criminologue à la direction des programmes Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DITSA-DP), auprès d’usagers et usagères qui présentent des troubles graves du comportement.
Une mission qui lui tient particulièrement à cœur.
Comprendre la personne avant tout
Si Henri Themens a choisi la criminologie, étude du phénomène criminel, c’est avant tout pour comprendre le comportement humain. C’est ce qui le guide dans son rôle de criminologue, au sein de l’équipe de réadaptation comportementale intensive (RCI).
L’objectif de cette équipe, composée d’éducateurs, éducatrices et spécialistes? Analyser le comportement et comprendre l’évolution des personnes qui développent des troubles graves du comportement (TGC), en soutien aux équipes cliniques en milieux de vie substitut.
En étroite collaboration, l’équipe RCI accompagne les équipes cliniques dans leurs interventions auprès d’usagers et usagères dont les troubles du comportement peuvent être dangereux pour elles et eux-mêmes, pour les autres et pour les membres du personnel.
Automutilation, agressivité, comportements sexuels inadéquats… les cas dans auxquels les professionnelles et professionnels de la RCI doivent intervenir sont multiples.
Au cœur de l’intervention, le bien-être des usagers et usagères reste central dans l’intervention. Henri explique :
« Plus le trouble du comportement est grave et plus les impacts sur l’usager ou l’usagère sont importants, plus on va essayer d’intervenir rapidement. »
Un métier clinique, des interventions variées
Pour y parvenir, les criminologues doivent faire preuve de rigueur avec bienveillance. Pour cela, leurs interventions suivent une démarche calibrée autour d’une étape initiale clé : l’analyse multimodale
Ce processus clinique, développé par le Service québécois d’expertise en TGC (SQETGC), vise à « analyser le comportement en tenant compte des éléments déclencheurs, contributeurs du message que la personne peut nous faire passer ». En d’autres termes, les professionnelles et professionnels s’attachent, en collaboration avec l’équipe clinique, à comprendre les causes du TGC, et l’humain qui est derrière.
Par la suite, les interventions sont variées : de l’intervention directe auprès des usagers et usagères, jusqu’au coaching des personnes intervenantes. Le tout, dans une approche positive visant à améliorer la qualité de vie des usagers et usagères. Ce qui a un impact sur le TGC et même sur la criminalité.
Prévenir la judiciarisation
Certaines personnes usagères courent le risque de rencontrer des problèmes de criminalités, et des conséquences légales.
Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à une évaluation criminologique pour identifier les facteurs de risque et de protection, afin de déterminer le niveau de dangerosité de la personne concernée. Des moyens d’intervention sont alors proposés pour, entre autres, prévenir les conséquences qui pourraient en découler, comme la judiciarisation.
Le programme Justice et santé mentale, au service des plus vulnérables
En raison de leur vulnérabilité, les personnes vivant avec une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme naviguent difficilement dans le système judiciaire, qui n’est pas du tout adapté à leurs réalités.
Dans ce contexte, le programme d’accompagnement justice et santé mentale vise à adapter le système judiciaire à la réalité des personnes accusées, ayant des vulnérabilités cognitives ou mentales.
Henri explique :
« Avec nos usagers et usagères, on peut par exemple établir des conditions à respecter, et les aider à s’impliquer dans la réadaptation menée par l’équipe clinique ».
Dans le cadre du programme Justice et santé mentale, Henri et son équipe reçoivent des usagers et usagères sur référence et interviennent en partenariat avec le SPVM, des avocats et avocates, des psychiatres et des intervenants et intervenantes du milieu communautaire. Dès la prise en charge dans le programme, toutes et tous mettent en œuvre des solutions pour éviter des conséquences juridiques et l’application de peines à leurs usagers et usagères, ou trouver des alternatives à l’incarcération.
Une ressource essentielle, qui évite à ces personnes l’expérience traumatisante du milieu carcéral.
Merci à Henri Themens et aux 84 criminologues du CCSMTL, qui accompagnent avec bienveillance et dévouement les usagers et usagères.
Sources
Forensia. (s. d.). Le START— Un guide pour l’évaluation et la gestion des comportements problématiques. https://forensia.ca/formations/start/
Gouvernement du Québec. (2025). Programme d’accompagnement justice et santé mentale. https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/programmes-contrevenants/accompagnement-justice-sante-mentale
Service québécois d’expertise en TGC (SQETGC). (2023). Outils archives. CIUSSS MCQ. https://www.sqetgc.org/outils/outils/?_categorie_outils_dropdown=outils








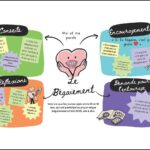



Un commentaire
Simple correction : J’accompagne * des usagers dans leur participation au PAJSM (Programme d’accompagnement justice santé mentale) et nous travaillons en partenariat avec des agentes de relations humaines qui elles reçoivent nos usagers (du CRDI) pour établir des cibles/conditions. Celles-ci visent une mobilisation dans la réadaptation et la réinsertion sociale permettant possiblement d’éviter une judiciarisation pour la personne lorsqu’elles sont respectées.